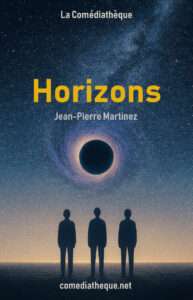
Dans un no man’s land aux allures de purgatoire, trois personnages qui ont perdu la mémoire fixent l’horizon en quête de réponses à leurs questions existentielles. Mais de quel horizon s’agit-il exactement ? Une tragi-comédie en forme de réflexion scientifique et philosophique sur le cycle éternel de la vie et de la mort.
Distribution : Les personnages sont de sexe indifférent, les distributions possibles sont : 3H, 3F, 2H/1F, 1H/2F
Pièce mise en ligne en octobre 2025
Traduction en espagnol par l’auteur : Horizontes
Traduction en anglais par l’auteur : Horizons
Traduction en portugais par l’auteur : Horizontes
Ouvrage paru aux Editions La Comédiathèque
ISBN 9782386023859
Octobre 2025
42 pages ; 18 x 12 cm ; broché.
Prix TTC : 12,00 €
Achat auprès de votre libraire et sur les plateformes
Résumé
Une tragicomédie métaphysique de Jean-Pierre Martinez
Dans un no man’s land aux allures de purgatoire, trois personnages, Ben, Dom et Max, se tiennent face à un horizon qu’ils scrutent sans comprendre où ils sont, ni qui ils sont. Ont-ils survécu à un crash aérien, sombré dans le coma, ou dérivent-ils dans l’espace aux confins d’un trou noir ? À travers leurs dialogues mêlant absurde, humour noir et vertige cosmique, ils explorent les limites de la conscience, du langage et de la mémoire.
Tantôt drôles, tantôt philosophiques, leurs échanges révèlent la condition humaine dans ce qu’elle a de plus universel : la quête de sens face au mystère de l’existence.
L’horizon devient alors métaphore de la vie, frontière mouvante entre le visible et l’invisible, la raison et l’inconnu.
Ben incarne la raison et le besoin de comprendre, Dom le doute et la dérision, Max l’intuition et l’imaginaire : trois facettes d’une même conscience humaine confrontée à son effacement.
À mesure que la pièce avance, leurs voix se confondent — comme si elles n’étaient que les fragments d’un seul esprit, à la frontière du néant.
Entre science et métaphysique, théâtre de l’absurde et poésie cosmique, Horizons est une méditation tragicomique sur la mémoire, la mort, et la possibilité de renaître autrement — quelque part, de l’autre côté de l’horizon.
Pièce à la fois limpide et vertigineuse, Horizons s’inscrit dans la tradition de l’absurde métaphysique, mais avec une modernité qui la distingue des œuvres de Beckett ou Ionesco. Ici, la réflexion ne tourne pas seulement autour du vide de l’existence, mais aussi autour de la science comme métaphore de l’inconnu.
Analyse
1. L’horizon comme métaphore centrale
L’horizon est à la fois un lieu, une limite, une illusion et une promesse.
Il symbolise :
la frontière mouvante entre la vie et la mort, le visible et l’invisible, le savoir et le mystère ;
la quête de sens humaine, condamnée à avancer vers un but qui se dérobe ;
la limite du langage et de la conscience : tout ce que nos mots et nos sens ne peuvent atteindre.
Comme dans un trou noir, plus les personnages s’en approchent, plus le sens semble s’effondrer sur lui-même.
2. La mémoire et l’identité
Les trois personnages ont perdu la mémoire, et cette amnésie devient une parabole : Que reste-t-il de nous quand nous avons tout oublié, même notre nom ?
Leur dialogue explore la fragilité de l’identité : sommes-nous ce que nous croyons être, ou ce que les autres voient de nous ?
Le nom, la mémoire, le corps et le langage sont les seuls repères encore vacillants d’une conscience en quête d’elle-même.
La pièce devient alors une réflexion sur le “je”, un “je” collectif, interchangeable, voire dissous.
3. La science et la métaphysique
Jean-Pierre Martinez marie ici l’imaginaire scientifique (trou noir, horizon des événements, mécanique quantique) à une métaphysique de l’existence :
L’univers devient miroir de la condition humaine : expansion, effondrement, relativité du temps.
Les références à la physique quantique et à l’astrophysique servent une réflexion poétique sur la coexistence des possibles : être mort et vivant à la fois, comme le chat de Schrödinger.
4. Langage, absurdité et condition humaine
Comme dans le théâtre de l’absurde (Beckett, Ionesco), le langage tourne sur lui-même, se répète, se contredit.
Les personnages parlent pour exister : “Tant qu’on parle, c’est qu’on n’est pas encore morts.”
Mais leurs mots trahissent la vacuité du sens : la langue est à la fois fenêtre et prison.
L’humour, parfois grinçant, révèle le tragique de leur condition : “Être mort, c’est comme être con. On ne le sait pas. C’est pour les autres que c’est difficile.”
5. La circularité du temps et de la vie
La pièce adopte une structure cyclique : chaque tentative d’explication retombe dans le doute.
La dernière image — un retour possible à la vie — fait écho à une conception orientale du cycle (renaissance, réincarnation, éternel recommencement).
Tout s’efface pour recommencer ailleurs, autrement : une chaos-comédie cosmique sur l’impermanence.
Caractérisation des personnages
Ben
Profil : rationnel, un peu philosophe, souvent celui qui cherche à mettre du sens dans l’absurde.
Fonction dramatique : il incarne la conscience réflexive — celui qui formule les hypothèses, essaie de comprendre, de relier les événements.
Tonalité : douce ironie, curiosité métaphysique. Il oscille entre scepticisme et désir d’espoir.
Dom
Profil : plus cynique, sarcastique, terre-à-terre. C’est souvent lui qui ramène le discours à l’absurde.
Fonction dramatique : la voix critique, celle du doute et de la dérision.
Il se moque des “phrases toutes faites”, refuse les illusions, mais cache une peur plus profonde : celle du néant.
Réplique emblématique : « Être mort, c’est comme être con. On ne le sait pas. »
Max
Profil : intuitif, rêveur, plus émotif. Il fait souvent le lien entre la science et la poésie.
Fonction dramatique : l’éveilleur — celui qui perçoit des images (l’avion, le trou noir), qui déclenche la mémoire symbolique.
Tonalité : visionnaire et fragile, oscillant entre lucidité et hallucination.
Ensemble, ils forment une trinité de la conscience humaine :
- Max = l’imaginaire
- Dom = le doute
- Ben = la raison.
Ils sont trois facettes d’un même être, trois voix d’une seule conscience perdue entre vie et mort.
Structure et rythme dramatique
La pièce progresse par hypothèses successives, chacune ouvrant un nouveau niveau de réalité :
Observation de l’horizon – conscience de la limite.
L’accident / la mort – hypothèse du crash.
L’hôpital / le coma – hypothèse du sommeil.
Le vaisseau spatial / le trou noir – basculement vers la métaphore cosmique.
Le retour possible / la renaissance – ouverture poétique et circulaire.
Cette construction en spirale évoque le mouvement de l’horizon lui-même, toujours fuyant, toujours recommencé.
Portée philosophique et poétique
Horizons interroge le mystère de la conscience :
Où commence et où finit “l’être” ?
Qu’est-ce que la réalité, si tout est perçu à travers le langage et la mémoire ?
L’univers a-t-il un sens, ou ne faisons-nous que projeter nos illusions dans le vide cosmique ?
Sous ses airs de conversation absurde, la pièce devient une méditation tragique et drôle sur la condition humaine : l’homme comme particule de conscience, perdu entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Conclusion
Horizons est une tragicomédie métaphysique, à la croisée du théâtre de l’absurde et de la poésie scientifique.
Dans un espace vide — le théâtre comme trou noir symbolique — trois consciences humaines débattent, ironisent, s’accrochent à la parole comme à la dernière trace de leur existence.
C’est une œuvre sur le sens, la mémoire, le langage et la mort, mais aussi sur la possibilité, même dérisoire, de continuer à parler, à rire et à espérer.

